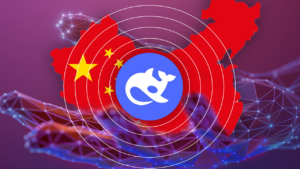Difficile de rivaliser avec le président des Etats Unis, pourtant, de plus en plus de personnes expriment leur mécontentement à travers le boycott des marques américaines, retour sur l’histoire d’un moyen d’action populaire.
Depuis le 20 janvier dernier et la prise de pouvoir du président des Etats-Unis Donald Trump, le monde fait savoir qu’il n’est pas d’accord avec les principes du chef d’Etat. Son moyen d’action, le boycott. Les premiers à utiliser ce moyen d’action furent les Latino-américains freinant considérablement leurs achats de Coca-Cola dès février. Le but, protester contre les décrets anti-immigration et l’augmentation des droits de douane. Ce premier boycott anti-Trump a provoqué une réaction en chaîne, s’exportant jusque chez nous, en France. Si les revendications se sont élargies et englobent maintenant l’intégralité de la politique trumpiste, le nombre de marques visées a lui aussi augmenté. MacDonalds, Starbucks, KFC, Tesla, … Si Coca-Cola reste la marque la plus impactée par le boycott, ces multinationales sont toutes touchées par le mouvement. Un effet compréhensible face aux 62% des Français qui soutiennent les appels au boycott (Ifop).
Phénomène de mode ? Pas sûr, depuis plus d’un mois, le mouvement ne s’essouffle pas. Même si des entreprises plus imbriquées dans le quotidien comme Apple ou Netflix ne sont pas encore vraiment impactées, l’implication des Français reste forte. Celui-ci s’additionne à d’autres mouvements de boycott envers les marques qui soutiennent Israël dans le conflit au Moyen-Orient, ou celles qui exploitent les populations Ouïghours en Chine… Si toutes ces causes ne parviennent pas à mobiliser la majorité des populations, elles ont un effet non négligeable: elles redonnent du pouvoir au plus grand nombre. Cette facilité à boycotter est le fruit d’un nombre important de luttes depuis 1880.
Tout commence avec un nom
Tout commence en Irlande, pays où réside le riche propriétaire terrien John Crichton. À ses ordres un certain Charles Cunningham Boycott. Ça y est le rapprochement est fait ? Après une année de mauvaises récoltes, les exploitants agricoles des terres de Crichton connaissent une fin de mois difficile et demandent à ce dernier de baisser les loyers. Dans sa grande bonté capitaliste Crichton… refuse, et envoie même Boycott expulser les récalcitrants. Il n’en fallait pas plus pour faire monter la solidarité plébéienne. Commerçants, domestiques, facteurs, ils ont tous refusé de le servir pour lui faire payer ses actes envers les agriculteurs. Et pour que la honte soit ultime, son nom s’installa dans le vocabulaire, s’exportant en France dès 1880.
Pourtant, tout ne fait que commencer, avec l’arrivée du XXe siècle. Au-delà des considérations de classes, les boycotts qui vont rythmer cette période vont ajouter des revendications ethniques ou religieuses. La transition se fait dès l’année 1900, dans l’empire tsariste. Une action est intentée envers un commerçant de tabac juif qui aurait licencié 45 employés. L’Union générale des travailleurs juifs (Bund) appela donc au boycott de ses cigarettes.
En 1930 en Inde, c’est cette fois l’empire britannique et ses impôts sur le sel qui sont visés par Gandhi. En 1955, rebelote cette fois aux Etats-Unis, avec le boycott des bus Montgomery lancé par Martin Luther King pour faire entendre la volonté de mettre fin à la discrimination raciale. Si ces combats sont menés à l’échelle nationale, ils sont tous dirigés vers une seule et même entité, les pouvoirs dirigeants. Les catégories opprimées se rendent compte que l’économie est un secteur sensible pour les oppresseurs et agissent en conséquence.

L’internationalisation du boycott…
Une mécanique qui va particulièrement se mettre en place en 1933, dans le premier grand boycott international mené envers les produits allemands. Le pays passé sous le joug des nazis de Hitler, les Juifs se retrouvent de plus en plus violentés par les autorités. Une situation intolérable pour les différentes institutions juives à travers le monde, mais pour qui il est difficile d’agir. C’est ainsi que démarre près de 8 ans de boycott, jusqu’à l’entrée en guerre des Etats-Unis. Si on peut la croire principalement symbolique, cette action montrera que le boycott a une capacité d’efficacité.
Les importations depuis l’Allemagne vers les Etats-Unis perdent un quart de leur volume. Goebbels prendra même la parole face à cette situation. La résistance juive ne plaît pas aux antisémites nazis qui, dans leur grande inventivité, lancent en représailles un boycott envers les commerçants Juifs allemands. Afin d’intensifier les pressions sur ces derniers, les sections d’assaut (SA) peignent des étoiles jaunes sur les devantures de leurs magasins. Cet épisode marque le début d’un nouveau type de revendication, le boycott d’Etat.
… à travers le sport
Loin des actions antisémites, les nouveaux boycotts d’Etats vont être construits sur des bases diplomatiques. Quoi de mieux que le domaine sportif pour se positionner contre l’apartheid ? En 1976, le Comité International Olympique (CIO) exclut la délégation sud-africaine des Jeux olympiques de Montréal, en réponse à la situation interne du pays. Une situation amplifiée par le boycott de 25 nations face à la complaisance de certains pays envers l’apartheid. Cette stratégie, qui touche la plus grande cérémonie sportive, envoie un message clair aux personnes visées. Il n’est donc pas étonnant qu’elle soit réutilisée quatre ans plus tard lors des jeux de Moscou. Cette fois, ce sont les Etats-Unis qui souhaitent protester contre l’intervention soviétique en Afghanistan. Seulement 80 pays participent à cette édition. Retour de bâton, l’URSS ne participera pas à l’édition suivante des JO, basée à Los Angeles.
Un long processus de démocratisation
Grâce à cette vitrine internationale, le boycott devient donc un concept récurrent et accessible partout dans le monde. Avec l’arrivée du XXIe siècle, les causes se multiplient et les boycotts aussi. Si certaines initiatives ont pu être sanctionnées par la justice, ce mode de militantisme reste généralement accepté, là où l’état de droit règne. Des applications ont même été créées pour identifier les marques à éviter pour ne pas financer des causes contraires aux valeurs des consommateurs. Si ce mode d’action ne permet jamais de régler à lui seul un conflit, il a toujours une part de responsabilité dans l’avancée des causes et des mentalités. Mesure facile à appliquer à son quotidien, le boycott reste, sans aucun doute, l’une des manières les plus efficaces de rester droit dans ses bottes.