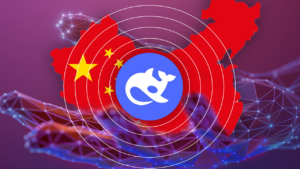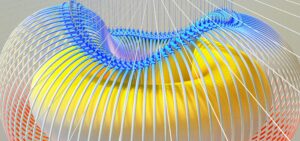« Au service de la nature », le principe du National Park Service américain, l’agence fédérale chargée de gérer et de protéger les 63 parcs nationaux du pays prend un tout nouveau sens depuis l’investiture de Donald Trump à la Maison Blanche depuis le 20 janvier 2025.
Au service de la nature depuis 150 ans, ces 63 parcs nationaux d’une beauté fascinante sont aujourd’hui menacés par le réchauffement climatique, luttant année après année pour rester des lieux coupés du monde.
Les parcs nationaux américains : des paysages à couper le souffle
Le Grand Canyon, la Sierra Nevada, Yosemite, Yellowstone, les Everglades, Zion, Acadia, Denali, Great Smoky Mountains, Saquaro, autant de parcs nationaux qui font la richesse de la culture et de la nature américaine. La diversité de la biodiversité et des écosystèmes ne manquent pas dans le troisième pays le plus grand du monde. D’une superficie de 9 631 417 km2, ces parcs nationaux abritent certains écosystèmes uniques au monde : des forêts denses du nord-ouest de la région des Grandes Plaines aux immenses lacs du Michigan. L’étendue de cette nature nous donne parfois le vertige par son immensité. Les Etats-Unis, le pays de l’abondance et de la démesure : des adjectifs qui s’appliquent également à ses paysages.
Aux quatre coins du pays, ces paysages grandioses sont le reflet de la diversité de l’écosystème américain. Les parcs nationaux sont vus par les Américains comme une part importante de leur identité depuis la création des Etats-Unis par les populations autochtones au XVIe siècle. Pour le reste du monde, ces parcs nationaux sont une exception propre aux États-Unis, qui attirent des millions de touristes chaque année. Pourtant, cet équilibre est aujourd’hui menacé, d’abord par le réchauffement climatique puis par l’administration Trump.
Les parcs nationaux américains ne sont pas épargnés par le réchauffement climatique

Cette espèce de puma n’est pas la seule espèce à souffrir du réchauffement de notre planète. En effet, au début du XIXe siècle, les pumas étaient très nombreux dans cette région et pourtant, depuis quelques années, le changement climatique a entraîné la dégradation de leur habitat naturel et a conduit in fine à la mise en danger de certaines sous-espèces. Les loups, les pikas, les mouflons du désert, le condor, les lamantins des Caraïbes, les dauphins, les salamandres, les lucioles, les lions de mer, les orques ou encore les wapitis sont toutes des espèces en voie de disparition dans les parcs nationaux américains, luttant pour leur survie au sein de leur habitat naturel.
Ces dernières années, le réchauffement climatique a considérablement augmenté les risques qui pèsent tant sur les espèces animales que végétales. Entre les incendies provoqués par les orages et l’activité humaine, les inondations ou encore les sécheresses, le danger ne fait que croître. Certaines de ces espèces continuent de se reproduire au sein des parcs nationaux américains, même si leur avenir est plus qu’incertain face aux facteurs environnementaux.
En 2022, l’augmentation de la température de la planète avait atteint 1,26 °C , selon l’Organisation des Nations Unies. Les scientifiques ont à maintes reprises alerté sur les dangers que représente le réchauffement de la planète, à la fois pour la survie des espèces animales mais aussi pour la survie de l’Homme. Pourtant, les objectifs ne sont pas les mêmes pour l’administration du nouveau président Donald Trump.
La protection de la biodiversité sous l’administration Trump : à quoi faut-il s’attendre ?

Au XVIe siècle, beaucoup percevaient ces grands espaces naturels comme une forme de frontière entre les tribus autochtones et les colons, lorsque la colonisation et l’inégalité entre les individus régnaient sur le territoire.
Mais aujourd’hui, ces parcs nationaux sont un facteur d’union pour la population américaine dans un pays divisé depuis l’arrivée de Donald Trump. Le 47ème président des États-Unis ne s’en est jamais caché : la protection de l’environnement n’a jamais été sa priorité. Businessman avéré, climatosceptique et défenseur de l’utilisation des énergies fossiles, les inquiétudes grandissent quant au sort réservé aux parcs nationaux américains.
En effet, lors de sa passation de pouvoir, Donald Trump définit le réchauffement climatique “d’escroquerie injuste et unilatérale” (- « unfair » and « rip-off”) avant de signer un décret pour retirer son pays de l’Accord de Paris sur le climat. Son arrivée politique sur la scène nationale et mondiale marque un réel recul dans la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, dès son premier mandat, son projet politique visait à soutenir le développement énergétique basé sur les énergies fossiles, notamment les forages de gaz et de pétrole dans les forêts nationales, à proximité de ces parcs nationaux.
Cependant, l’administration Trump ne s’attaque pas encore aux parcs nationaux américains. Bénéficiant d’un fort soutien du National Park Service (NPS), ces parcs restent protégés à travers des ambitions de préservation de la biodiversité et de sauvegarde de la faune et de la flore. De plus, de nombreux sites sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis 1945, L’UNESCO vise à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d’éducation, de science et de culture et regroupe une délégation de 195 Etats membres et 8 membres associés.
Au coeur du pouvoir politique : quel est le rôle du Congrès aujourd’hui ?

À la fin du XVIIIe siècle, le Congrès américain adopte une loi pour la protection des bijoux naturels américains lors de la découverte des premiers parcs nationaux. Ainsi la création de l’agence National Park Service (NPS) remonte au 25 août 1916 par cette loi du Congrès américain qui poursuit un but de « conservation et de protection des paysages, des sites naturels et historiques, de la faune, de la flore afin de les transmettre intacts aux générations futures afin qu’elles puissent elles aussi les admirer comme nous l’avons fait en notre temps ».
Le rôle du Congrès américain est déterminé par l’article 1 de la Constitution des États-Unis: il est chargé d’élaborer, de discuter et de voter les lois. Il exerce également un pouvoir sur le budget fédéral des États-Unis, le commerce et la défense du pays. Le Congrès est la seule instance qui a le pouvoir de prise de décision sur les lois fédérales, les taxes fédérales, les déclarations de guerre et la mise en application des traités. Donald Trump a souvent exprimé des critiques envers les décisions du Congrès américain, notamment lorsqu’il estimait que les membres de cette institution s’opposaient à ses politiques ou à ses initiatives. Cependant, Donald Trump ne pourrait s’en prendre au Congrès américain car il perdrait un soutien politique considérable détenu par le Congrès en évitant de s’attirer les foudres de cette institution politique.
Donald Trump reste conscient de l’importance stratégique de maintenir une relation avec cette institution pour réussir les objectifs politiques à atteindre. Cela l’incite à éviter une confrontation trop directe avec l’ensemble du Congrès américain. Quel est l’avenir des parcs nationaux américains sous la deuxième administration Trump ? Osera-t-il se confronter à l’institution américaine pour atteindre ses objectifs économiques au détriment de la préservation des parcs ?
Pour en savoir plus sur les enjeux du changement climatique sous l’administration Trump, cliquez sur ce lien https://www.csactu.fr/les-etats-unis-de-donald-trump-face-au-defi-du-changement-climatique/