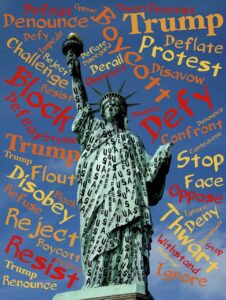Depuis la mi-avril 2025, une série d’attaques coordonnées visant des établissements pénitentiaires français a mis en lumière l’émergence du groupe DDPF, acronyme de « Défense des droits des prisonniers français ». Ce collectif, apparu sur Telegram quelques jours avant les incidents, se présente comme un mouvement de défense des droits humains en milieu carcéral, dénonçant la surpopulation, les conditions de détention et les violences institutionnelles. Cependant, ses actions violentes et sa rhétorique menaçante soulèvent des interrogations sur ses véritables motivations et sur la manière dont ses revendications s’inscrivent dans le contexte actuel du système pénitentiaire français.
Des revendications centrées sur les droits des détenus
Le groupe DDPF affirme agir en réponse à une situation carcérale jugée alarmante. La France connaît en effet une surpopulation pénitentiaire chronique, avec un taux d’occupation atteignant 131 % . Les membres du DDPF dénoncent également des conditions de détention qu’ils estiment indignes, des violences de la part du personnel pénitentiaire et une politique de plus en plus répressive à l’égard des détenus. Ils se positionnent comme des défenseurs des droits humains, rejetant l’étiquette de terroristes et revendiquant une action militante en faveur des prisonniers.
Des actions violentes et coordonnées
Malgré leur discours axé sur la défense des droits, les actions du DDPF ont été marquées par une violence notable. Entre le 13 et le 16 avril 2025, plusieurs établissements pénitentiaires ont été la cible d’attaques : véhicules incendiés, tirs d’armes automatiques sur des façades de prisons, notamment à Toulon-La Farlède, et inscriptions du sigle « DDPF » sur les lieux des incidents . Ces attaques ont suscité une vive réaction des autorités, qui les considèrent comme des tentatives de déstabilisation de l’État et ont ouvert une enquête antiterroriste.
Un contexte carcéral sous pression
Les revendications du DDPF interviennent dans un contexte où le système pénitentiaire français est soumis à de fortes tensions. Outre la surpopulation, le gouvernement a récemment annoncé des mesures visant à isoler les détenus considérés comme les plus dangereux, notamment les narcotrafiquants, dans des établissements à sécurité renforcée. Cette politique, perçue par certains comme une réponse sécuritaire aux problèmes structurels des prisons, est critiquée pour son manque d’approche humaniste et pour les risques qu’elle fait peser sur les droits fondamentaux des détenus.
Une légitimité contestée
Si les préoccupations soulevées par le DDPF trouvent un écho chez certains défenseurs des droits des détenus, la légitimité du groupe est largement remise en question en raison de ses méthodes violentes. Les autorités soupçonnent des liens avec des réseaux de narcotrafiquants cherchant à déstabiliser le système carcéral pour préserver leurs intérêts. Cette ambiguïté complique la lecture des véritables intentions du DDPF et soulève des inquiétudes quant à l’instrumentalisation des revendications des détenus à des fins criminelles.