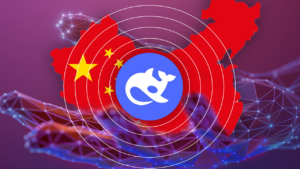Plan massif d’expulsion de migrants, démantèlement de départements entiers de l’État fédéral en passant par l’idée de transformer Gaza en côte d’Azur orientale. Dès les premières semaines de la présidence Trump, des décrets ont été signés en cascade, des phrases chocs ont été distillées lors de conférences de presse improvisées et le vocable américain a été utilisé de manière complètement arbitraire par le magnat de l’immobilier. Comment faire le tri dans tout cela ? La vague est telle qu’il est difficile pour les journalistes de prendre du recul pour savoir ce qui relève d’une véritable mesure ou d’une simple diversion.
Difficulté à démêler le vrai du faux
“On voit un peu que ça part dans tous les sens, en plus il fait beaucoup de digression donc on attend un peu qu’il finisse de parler, et on fait un petit résumé de sa parole tout en précisant des fois parfois qu’il y a des passages que l’on n’a pas très bien compris”, raconte Enora Ollivier rédactrice en chef adjointe à la rédaction Web du Monde, dans un podcast de l’Heure du Monde (Donald Trump : les journalistes au défi de couvrir sa présidence “tous azimuts”). Plusieurs challenges sont donc à relever pour les journalistes comme l’explique Stéphanie Le Bars, cheffe du service International du Monde, dans le même podcast. “D’abord, il faut gérer l’abondance”, avant de “déterminer la nature des annonces”. Avec le président Trump, la hiérarchie des annonces n’existe plus.
Alors comment couvrir cette avalanche d’annonces ? Pour Marie-Christine Bonzom, politologue, journaliste spécialiste des États-Unis et ancienne correspondante à la BBC à Washington, “les médias américains doivent continuer à couvrir Trump avec agressivité, mais cette fois en revenant aux fondamentaux du métier”. Faire la différence entre le factuel et le commentaire et laisser ses opinions personnelles au vestiaire est primordial. La rigueur doit donc être de mise face à la Maison Blanche qui, quel que soit son locataire, cherhe toujours à « ‘contrôler le narratif’, ce qui veut toujours dire ‘contrôler le message’ et ce qui veut parfois dire ‘tordre la vérité’ ou ‘dissimuler des faits’”, selon la spécialiste des Etats-Unis.
7j/7, 24h/24
Ce qui est nouveau pour les journalistes, c’est l’omniprésence de la parole présidentielle. A l’inverse de Joe Biden qui ne s’exprimait que très rarement lors de conférences de presse, le nouveau président des Etats-Unis est incroyablement disponible pour les journalistes. Même en déplacement à Mar-a-Lago, son luxueux refuge, il lui arrive de recevoir des journalistes dans son avion. Avec lui, ça n’arrête jamais. Il est son propre éditorialiste, son propre commentateur. Marie-Christine Bonzom en témoigne : “Le président Donald Trump mène une stratégie de saturation du discours public. Avec un rythme d’activité visible encore plus soutenu qu’au début de son premier mandat”. Et d’enchaîner : “Il agit vite et tous azimuts, car il n’a vraiment que deux ans pour réaliser son programme”.
Stratégie médiatique submersive
Une stratégie qui n’est pas anodine de la part du locataire de la Maison Blanche. Bien au contraire. Elle est revendiquée et théorisée par son ancien conseiller Steve Bannon, aujourd’hui co-animateur du podcast War Room. Il déclarait dans celui-ci : “Je crois très fort à cette théorie d’inonder la zone, c’est-à-dire submerger l’opposition et je pense que le président Trump fait une chose incroyable pour parler de tous les sujets et marteler des ordres exécutifs et des actions exécutives, tout ça”. Le président américain mène une véritable stratégie de saturation de l’espace médiatique. Son ancien conseiller explique d’ailleurs que le véritable opposant à Donald Trump n’est pas politique mais médiatique.
C’est même presque devenu sa marque de fabrique. Certes, il a une équipe de communication et une porte-parole endurcie, mais pour la politologue spécialiste des Etats-Unis, “sa stratégie médiatique est construite sur sa « marque », sa personne, son personnage, sa rhétorique, son programme, voire ses idées, colères ou obsessions du moment”. Il est constamment sur le pont et fait des relations avec les médias une de ses priorités. “Trump est en campagne électorale permanente à travers les médias. Plus encore qu’en 2016, il est son principal porte-parole”, insiste Marie-Christine Bonzom.
Pression sur les médias nationaux
Alors, certains s’opposent. Beaucoup critiqués pendant le premier mandat Trump pour avoir sur-médiatisé ce qu’on appelle le “Trump-show”, beaucoup de médias ont pris position cette fois-ci en dénonçant les positions anti-démocratiques de ce dernier. C’est le cas du New York Times et du Washington Post. Pourtant, ces prises de position ne semblent pas avoir de véritables conséquences sur les citoyens américains puisqu’il entame son second mandat. Une conséquence pouvant venir du manque de confiance des Américains dans les médias nationaux, comme le souligne Marie-Christine Bonzom.“La seconde présidence Trump intervient à un moment où la confiance des Américains dans leurs médias d’information est au plus bas”.
Cette seconde présidence ne fait d’ailleurs pas figure d’exception concernant les attaques à l’égard des journalistes. Elles sont nombreuses. Encore récemment contre un journaliste du Washington Post, Eugène Robinson par exemple. Le président américain a demandé son renvoi pour “propagande pathétique de gauche” après que le journaliste ait critiqué Elon Musk pour avoir « essayé de décimer » la fonction publique. Le président des Etats-Unis l’a alors traité publiquement d’incompétent. On observe également une certaine forme de pression sur les grandes chaînes de télévision pour qu’elles mettent un genou à terre. Nombreuses sont celles ayant supprimé les programmes Diversité, Equité et Inclusion (DEI), signe de la victoire culturelle du président des Etats-Unis.
Il est néanmoins important de nuancer en rappelant qu’en raison de leurs intérêts divergents, les relations entre la Maison Blanche et les médias américains n’ont jamais vraiment été de tout repos. Ce n’est donc pas l’apanage de Donald Trump, même si la situation a empirée sous ses présidences. Joe Biden était extraordinairement peu accessible aux médias tandis que Barack Obama se montrait très agressif à l’égard de ces derniers. Il en revient donc au Quatrième pouvoir de tout faire pour établir la vérité.